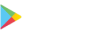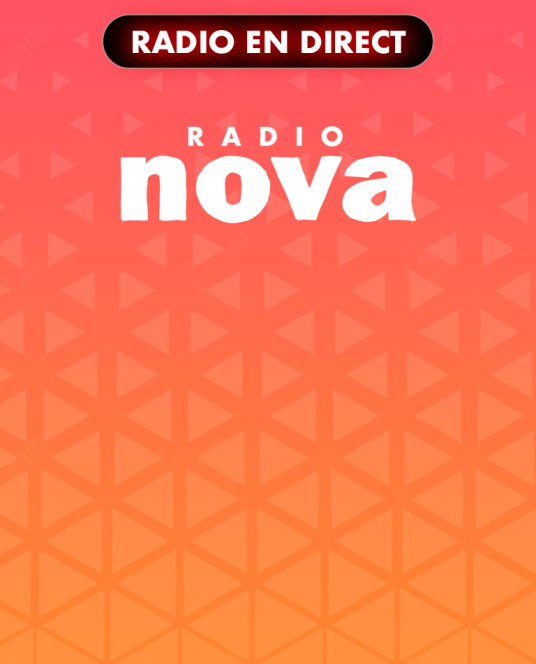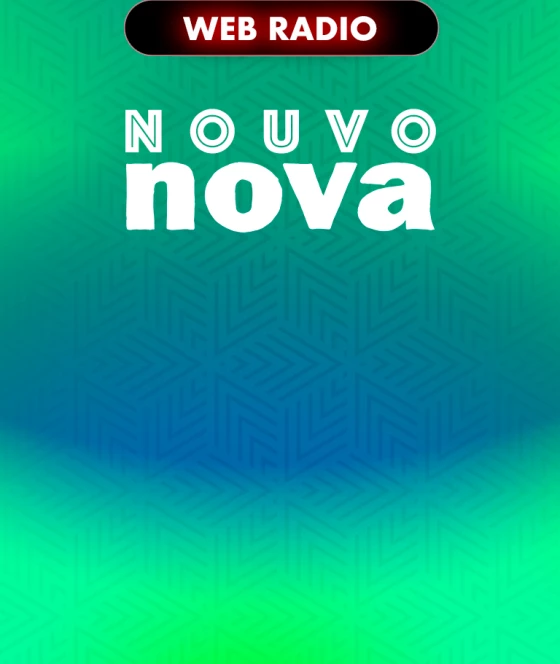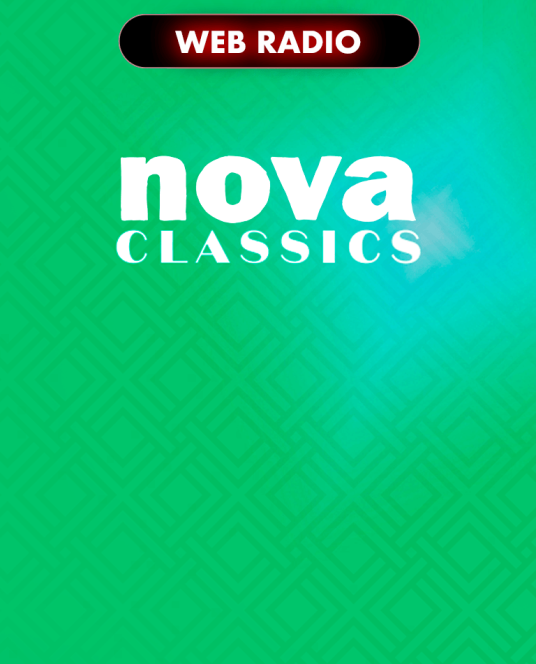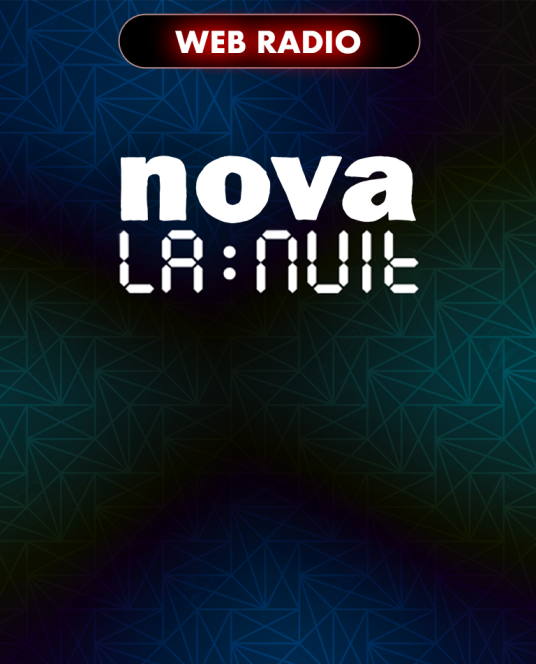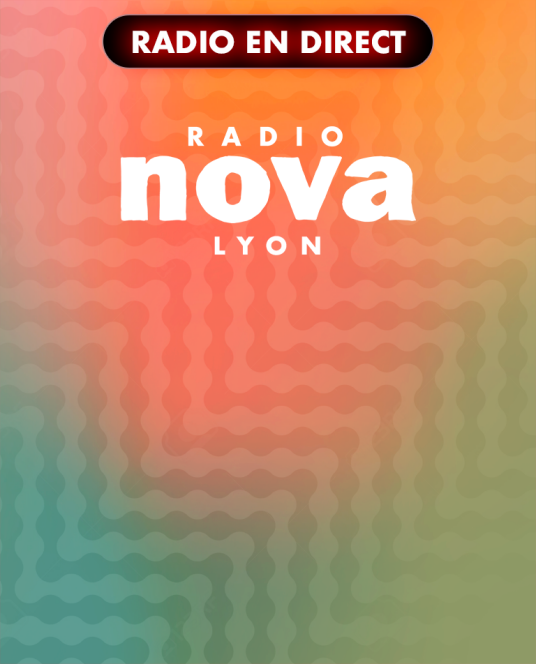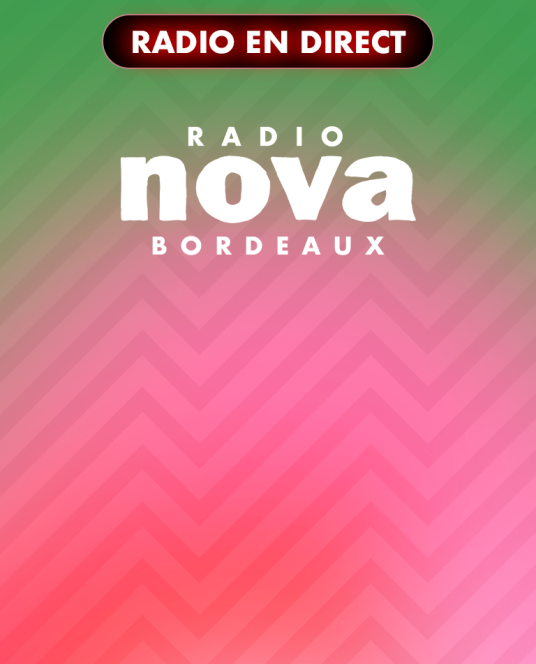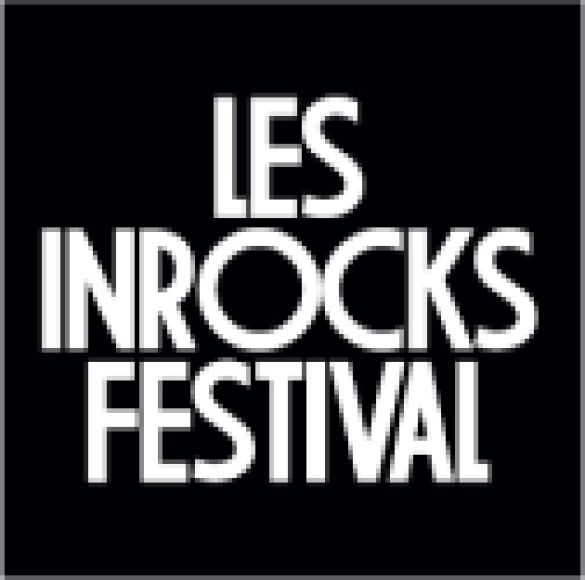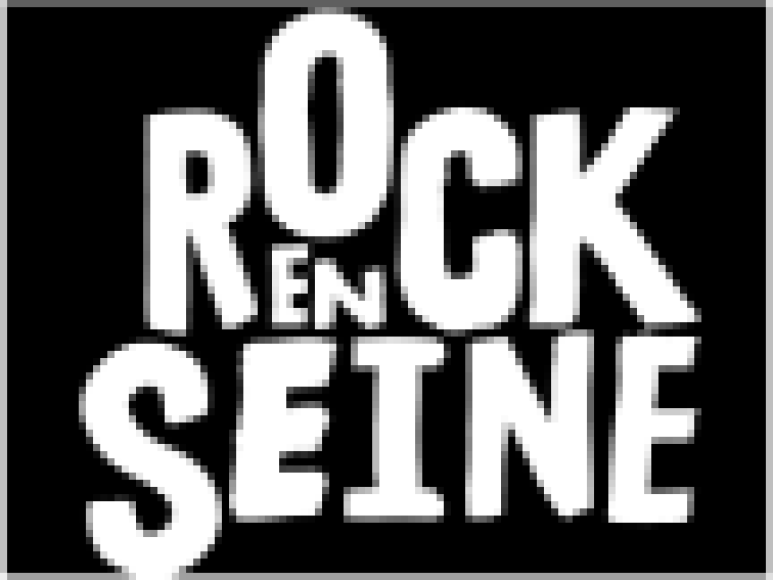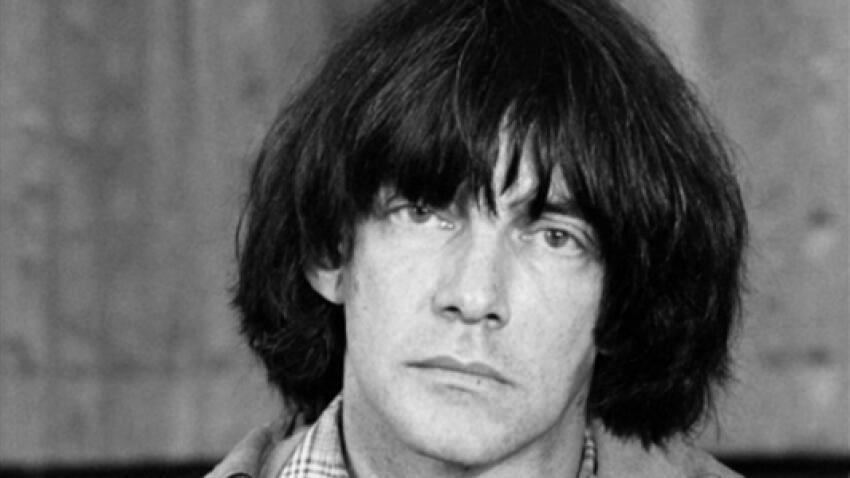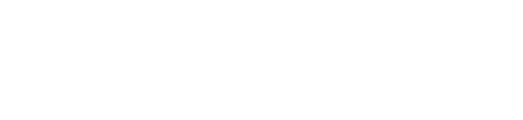A l’annonce du décès du philosophe, le journaliste et écrivain Patrice Van Eersel, pionnier du magazine Actuel, publiait ce mardi 10 novembre, cette tribune .
André Glucksmann vient de mourir et ça me fait quelque chose. Je l’avais cotoyé quelquefois. A Libé, en 73, quand il s’était pointé avec les épreuves de « La Cuisinière et le mangeur d’hommes », son essai sur les rapports entre le marxisme et le totalitarisme. Pour ses copains maos de l’ex-GP et de la Cause du peuple, c’était un choc. Ils se disaient pourtant « anti-stal » depuis longtemps, mais attaquer carrément le marxisme, c’était quand même tabou. Gluck’s, lui, y allait franchement. Via Soljenitsyne, dont il nous invitait instamment à lire l’énorme « Archipel du Goulag », remise en cause radicale et totale du marxisme-léninisme et même du marxisme tout court. En fait, notre ami ouvrait la marche de ce qu’on allait appeler les « Nouveaux philosophes », quand BHL mettrait tout ça en scène, obtenant, trois ans plus tard, en 1976, la une du magazine Time. Avec cinq ou six autres, dont Christian Jambet, Guy Lardreau et les époux Broyelle, sans oublier Bernard-Henri Lévi himself of course, tous ces ex-maos expliquaient en gros, si je me souviens bien, que la terreur idéologique (et non pas religieuse), c’est nous, les Français, qui l’avions inventée, en 1793, servant de modèle à tous les staliniens et Khmers rouges de la terre.
Par la suite, j’ai plusieurs fois revu André Glucksmann, notamment quand le second mensuel Actuel lui confia une chronique, dans les années 80. Mais je me souviens surtout du 10 novembre 1989 (il y a 26 ans jour pour jour). Le mur de Berlin était tombé la veille et le journal nous envoya tous les deux là-bas. Une amie journaliste du TAZ, le Libé berlinois, Renée Zucker, nous fit faire le tour des brèches principales par où la foule de l’Est se répandait dans la partie Ouest de ce qui allait redevenir la capitale de l’Allemagne réunifiée. Avec Gluck’s, je me souviens que nous frappa la relative méfiance avec laquelle les Berlinois occidentaux voyaient déferler ceux qu’ils n’allaient pas tarder à appeler les « Bananen-fresser », les bouffeurs de banane (je ne sais plus au juste pourquoi, peut-être parce que c’était le seul fruit exotique que le régime communiste pouvait offrir à ses citoyens, via Cuba ou le Mozambique – ou parce que c’était la seule chose qu’ils pouvaient s’offrir dans les supermarchés ultra riches de la moitié Ouest, qu’ils lorgnaient avec les yeux qui leur sortaient de la tête). Nos amis Berlinois occidentaux se plaignaient aussi de la pollution énorme que répandaient les tuyaux d’échappement des Trabant, l’espèce de 2CV de la RDA.
Avec André, nous visitâmes aussi des types de l’Est, comme Volker Handloik, ex-dissidents courageux qui avaient osé braver la Stasi, mais qui à présent se refusaient farouchement de courir comme des rats à travers les trous creusées dans le mur, campant dans une attitude utopique, qui durerait quelques mois, s’imaginant que l’ex-RDA allait pouvoir devenir une sorte de terrain expérimental de la démocratie participative et directe, avec des forums populaires où tout serait discuté ouvertement. André n’y croyait pas une seconde (la question était plutôt de savoir quelle forme allait prendre le rachat de l’Est par le capitalisme de la République Fédérale), mais il s’efforçait de ne pas décourager le vaste enthousiasme qui emportait à présent la jeunesse d’un peuple entier. Et nous allions de pots en pots, des centaines d’appartements privés ayant été transformés en petits cafés sauvages.
En réalité, André Glucksmann était préoccupé par tout autre chose que l’avenir de l’Allemagne de l’Est. Il me disait : « Le danger de la Perestroïka lancée par Gorbachev et du réveil des peuples que le stalinisme avait congelés, c’est que le chaos s’installe en Europe centrale et orientale. Car ce chaos est toujours un immense danger pour le peuple juif. » Et comme je lui demandais quelle perspective positive pouvait être envisagée, il me répondit : « La seule force qui puisse stabiliser l’Europe centrale, c’est l’Allemagne. Il faut aider le gouvernement fédéral à remplir cette fonction. » C’est pourquoi, à mon (relatif) étonnement (après tout, il avait aussi été l’un des premiers ex-gauchistes à saluer le génie du général De Gaulle), il m’expliqua qu’il appréciait la démocratie chrétienne allemande, et notamment Helmut Kohl, en qui il avait grande confiance et avec qui il avait déjà noué une amitié. Dix-huit ans plus tard, quand Gluck’s prit parti pour Sarkozy en France (pour secouer l’idée reçue qu’un intellectuel lucide devrait forcément être « de gauche »), j’ai idée que c’était un peu dans la continuité de ce qu’il m’expliqua alors à Berlin.
Rentrant à Paris, comme je lui racontais certains de mes autres centres d’intérêt, regroupés à l’époque sous l’appellation « New Age » – de l’accompagnement des mourants à la communication avec les dauphins, en passant par le métissage musical de la Sono mondiale et l’exploration des relations corps-esprit –, André Glucksmann s’esclaffa : « Tu te serais senti bien sous Charles IV, le roi de Bohème du 14ème siècle qui invitait à sa cour tous les savants, artistes, mages et magiciens de toutes obédiences, pour tenter de renouveler une sorte de civilisation andalouse – au demeurant à moitié mythique. »
Le rêve andalou, où musulmans, juifs et chrétiens vivaient (ou étaient censés vivre…) en harmonie, ça me parlait beaucoup. Alors, Gluck’s fit une grimace : « Pas évident à reproduire. Charles IV était un humaniste. Mais renouveler son entreprise s’est avérée impossible. Quand son descendant protestant Frédéric V s’y essaya, au 17ème siècle, l’empire catholique l’écrasa, à la fameuse bataille de la Montagne blanche, en 1620. Sais-tu qui ferraillait alors, dans les troupes impériales commandées par Maximilien de Bavière ? René Descartes. »
A l’époque, je m’étais juré d’approfondir cette discussion avec André… Je voulais qu’il m’explique en particulier pourquoi il pensait que toutes les pensées utopiques conduisent forcément à l’oppression et pourquoi il disait comme Churchill : « La démocratie parlementaire est le pire des régimes, à l’exception de tous les autres. » Philosophiquement, il m’avait dit, je crois, que cela signifiait ceci : il ne faut jamais tenter d’instaurer le bien, mais toujours résister au mal. Et je comprenais bien ce qu’il voulait dire, mais avec une grande difficulté à m’imaginer gouverner ma vie et élever mes enfants ainsi.
Sans doute était-il le plus sage. Mais comme souvent, j’ai procrastiné, et les rares fois où nous nous sommes revus, ce fut pour aborder des questions beaucoup plus urgentes, en rapport avec son engagement incessant auprès de tous les dissidents possibles, en résistance contre toutes les formes d’oppression – combat si bien repris aujourd’hui par Raphaël, le si lumineux fils de Gluck’s et Fanfan.
Maintenant, s’il y a une Lumière de la conscience au-delà des apparences, Dédé doit être au courant. Le cas échéant, je lui souhaite de tout cœur d’y faire le moins mauvais des voyages possibles ! Hasta luego, compañero !
Un texte publié à l’origine sur la page facebook de Patrice Van Eersel
Vous pouvez également retrouver le podcast de notre rencontre avec son fils Raphaël Glucksmann.